Graham Greene : « Pas de baie des Cochons pendant la terreur de Batista »
Le Monde diplomatique publiait en juin 1984 un extrait du livre Les Chemins de l’évasion de Graham Greene, à l’occasion de sa publication chez Robert Laffont (308 pages). Selon l’éditeur « Graham Greene reprend le fil de ses souvenirs, interrompu à la fin de son volume Une sorte de vie, qui recouvrait ses jeunes années(…) Il s’est attaché à retracer quelques unes des expériences marquantes qui ont jalonné une longue et riche existence ».
L’extrait choisi par Le Monde diplomatique porte sur les années Batista à Cuba. Le titre est du mensuel.
Voici ce texte de Graham Greene (p. 239-247) après les quelques lignes de présentation du Diplo.
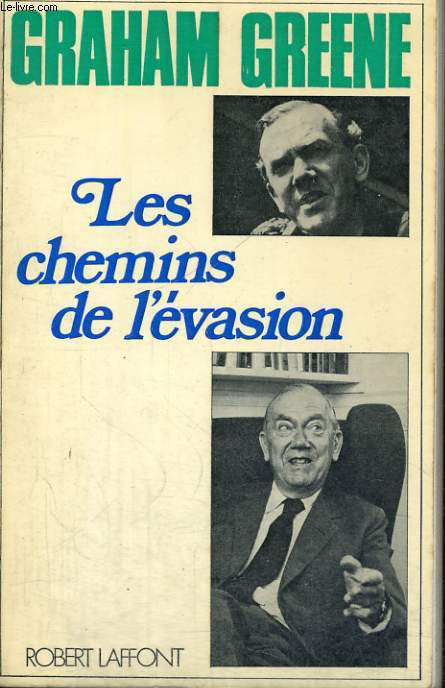
Graham Greene : « Pas de baie des Cochons pendant la terreur de Batista »
(source : Le Monde diplomatique)
« C'est en 1958 que Graham Greene publia Notre agent à La Havane. Ce roman était l'aboutissement d'expériences cocasses en divers pays et de plusieurs voyages à Cuba au temps de la dictature de Batista. Dans Les Chemins de l'évasion (éd. Robert Laffont), Graham Greene raconte comment il fit quelques séjours à La Havane au début des années 50, puis, en 1957, une visite à Santiago-de-Cuba où le général Chaviano dirigeait les opérations lancées centre les maquisards de Fidel Castre dans la Sierra Maestra. Les extraits que nous publions ci-dessous rappellent ce qu'était la dictature qui donna naissance à la révolution. Témoignage sur un régime que seule la violence pouvait renverser, ce texte garde, près de trente ans plus tard, toute sa signification pour les pays où sévit encore une terreur contre laquelle le peuple s'insurge »
« J'AIMAIS l'atmosphère louche de la ville de Batista, et je n'y demeurais jamais assez longtemps pour prendre conscience du triste arrière-plan politique, des emprisonnements arbitraires et de la torture. J'allais à La Havane ("en quête de plaisir pour ma punition", comme l'écrivit Wilfred Scawen Blunt) pour le restaurant Floridita (dont les daiquiris et le crabe Morro étaient célèbres), pour la vie des bordels, la roulette dans tous les hôtels, les machines à sous crachant des flots de dollars d'argent, le théâtre Shangaï, qui proposait, pour 1,25 dollar, un spectacle de cabaret extrêmement obscène et des films pornos particulièrement raides pour meubler les entractes (le foyer comportait une librairie pornographique pour les jeunes Cubains fatigués du spectacle). Je fus soudain frappé par l'idée que cette ville étonnante, où tous les vices étaient permis et tous les commerces possibles, constituait la véritable toile de fond de ma comédie.

(...) Bizarrement, c'est en travaillant à mon projet de comédie loufoque que j'ai découvert certains aspects de la réalité cubaine sous Batista. Jusque-là, je ne connaissais aucun Cubain. Je n'avais jamais voyagé à l'intérieur du pays. Mais, à mesure que l'intrigue prenait forme, je me mis en devoir de remédier en partie à mon ignorance. Je me fis des amis parmi la population, louai une voiture et un chauffeur afin de circuler dans le pays. Le chauffeur était superstitieux, et mon éducation commença dès le premier jour, lorsqu'il écrasa accidentellement un poulet : il m'initia alors aux symboles de la loterie - nous avions écrasé un poulet, il fallait donc jouer tel et tel numéro. Voilà ce qui remplaçait l'espérance dans un Cuba désespéré (...).
UN seul endroit de l'île était demeuré inaccessible : Santiago, la deuxième ville cubaine, devenue quartier général des opérations menées contre Fidel Castro, lequel lançait périodiquement des attaques depuis les montagnes où il s'était réfugié avec sa poignée de partisans. C'était le début de la période héroïque. La province d'Oriente, hommes, femmes et enfants (je dis enfants en connaissance de cause), jusqu'au dernier habitant ou presque, était du côté de Fidel. Des barrages militaires bloquaient les routes autour du chef-lieu d'Oriente, et tout étranger qui arrivait à bord d'une voiture particulière était suspect. A neuf heures du soir commençait un couvre-feu officieux, mais qu'il était dangereux d'ignorer. Il y avait des arrestations arbitraires, et il n'était pas rare de découvrir, au lever du jour, un cadavre pendu à un réverbère. Encore celui-là avait-il eu de la chance. Un certain immeuble devait aux cris qui s'en échappaient, et qu'on entendait depuis la rue, une sinistre réputation. Après que Santiago fut tombé aux mains de Fidel, on découvrit dans la campagne, hors des limites de la ville, un charnier où s'empilaient les corps mutilés.
Peu de temps auparavant, l'ambassadeur des Etats-Unis, à qui revenait la tâche peu plaisante de soutenir Batista, avait été reçu officiellement à Santiago par le maire de la ville. Une manifestation improvisée par les femmes de Santiago fut assemblée à la vitesse éclair qu'un régime de terreur peut susciter. Toutes classes confondues, car on en était encore au stade de la révolution nationale, paysannes et bourgeoises s'unirent pour entonner des chants patriotiques devant l'ambassadeur américain, qui les observait depuis le balcon de l'hôtel de ville. Les militaires ordonnèrent aux femmes de se disperser. Elles refusèrent. L'officier responsable fit donner les lances d'arrosage. L'ambassadeur mit fin à la cérémonie, ce qui est tout à son honneur. Il déclara qu'il n'allait pas rester là pendant que des femmes étaient brutalisées. Son attitude lui valut un rappel à l'ordre de John Foster Dulles : il avait commis une violation de la neutralité. Pas de "baie des Cochons" pendant le règne de la terreur de Batista. Aux yeux du gouvernement américain, il n'y avait de terreur que venant de la gauche. Par la suite, lors d'un cocktail diplomatique à La Havane, j'eus l'occasion d'évoquer l'attitude de l'ambassadeur américain devant le représentant de l'Espagne. "C'était absolument contraire aux usages diplomatiques", me dit-il.
"Qu'auriez-vous fait ?
. J'aurais tourné le dos."
ON ne pouvait se rendre à Santiago autrement que par avion. La veille de mon départ, je me trouvais à une soirée en compagnie de quelques amis cubains, tous issus de la moyenne bourgeoisie et tous partisans de Fidel (quoique l'un deux au moins ait quitté Cuba depuis cette époque). Une jeune femme parmi les invités avait été arrêtée par le trop célèbre chef de la police de Batista, le capitaine Ventura, et passée à tabac. Une autre fille affirma qu'elle servait de messagère à Fidel. Elle partait par le même avion que moi et me demanda de prendre dans ma valise un tas de pull-overs et de grosses chaussettes dont les hommes retranchés dans les montagnes avaient grand besoin. A Santiago, il faisait une chaleur tropicale, et la présence de vêtements d'hiver dans la valise d'un voyageur étranger serait plus facile à justifier lors du passage à la douane de l'aéroport. La jeune fille tenait à me faire rencontrer les représentants de Fidel à Santiago - les vrais, me dit-elle, car la ville, et tout particulièrement l'hôtel où je descendais, grouillait d'espions de Batista.
(...) Le lendemain matin, le correspondant de Time vint me voir. Son magazine l'avait chargé de m'accompagner à Santiago afin de m'apporter toute l'aide dont je pourrais avoir besoin. Je ne désirais aucune aide, mais son journal estimait visiblement que je pourrais, sous une forme ou sous une autre, fournir la matière d'un paragraphe. Il fallait que je retrouve la fille afin de l'avertir que je ne serais pas seul. Malheureusement, j'ignorais son nom et son adresse, et mon hôte de la veille n'était pas mieux informé. Toutefois, il me conduisit en voiture à l'aéroport et fit le guet près de l'entrée tandis que j'attendais au bar. Il revint finalement, porteur du message suivant : je ne devais par reconnaître la fille durant le voyage ; elle me téléphonerait le lendemain matin à mon hôtel.
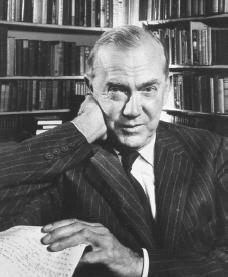
L'HOTEL se trouvait au coin de la petite place principale de Santiago : d'un côté, on voyait la cathédrale dont le flanc était bordé de boutiques. Deux taxis et un fiacre semblaient avoir abandonné tout espoir de voir surgir un client. Personne ne venait plus à Santiago, excepté peut-être les espions contre lesquels on m'avait mis en garde. La nuit était chaude et humide ; l'heure du couvre-feu officieux approchait et le réceptionniste ne faisait même pas semblant de se montrer accueillant. Les taxis ne tardèrent pas à reprendre le chemin du garage, la place se vida, un peloton de soldats passa, un homme en costume de coutil d'un blanc douteux se mit à se balancer d'arrière en avant dans un rocking-chair du hall de l'hôtel, créant un léger courant d'air dans le soir infesté de moustiques. Je songeai à Villahermosa pendant les persécutions dans la région du Tabasco. La ville sentait le poste de police. Je me retrouvais dans ce que mes critiques imaginent être Greeneland.
Le lendemain matin, on frappa à ma porte pendant que je prenais mon petit déjeuner - c'était le correspondant de Time, accompagné d'un homme d'âge moyen, vêtu d'un élégant complet de gabardine et affichant un sourire commercial. Il me fut présenté comme le chargé des relations publiques de Castro à Santiago - il ne semblait pas venir de la même planète que les guérilleros retranchés dans les montagnes proches. J étais gêné, car le téléphone pouvait sonner d'un instant à l'autre. J'essayai de persuader mon visiteur de revenir un peu plus tard, quand je serais habillé. Il continua de parler - et le téléphone sonna.
A cet instant, j'étais si bien persuadé que le danger des "espions" était réel que je demandai à M. X... et au correspondant de Time de quitter la pièce pendant que je répondais. Ils s'exécutèrent à contrecœur. C'était la fille, et elle me priait de me rendre à un certain numéro de la calle San-Francisco. M. X... fit sa réapparition et me déclara qu'il était certain que je venais d'être contacté par un agent de Batiste. Aucun membre de son réseau n'aurait fait preuve d'une telle légèreté... il exigea de connaître la teneur de ma conversation téléphonique.
J'étais en colère. Je n'avais pas demandé à être mêlé à toute cette histoire. Je soulignai que pour ce que j'en savais, il pouvait être lui-même un agent de Batista. C'était l'impasse, et il s'en alla.
MON problème consistait à présent à trouver cette rue. Je craignais même de demander un renseignement au réceptionniste. Je gagnai la place et allai m'installer dans un des deux taxis à l'abandon. Avant que j'eusse pu adresser la parole au chauffeur, un Noir à la mise voyante vint s'asseoir à côté de lui. "Je parle britannique, annonça-t-il. Je vous montre où vous voulez aller." S'il y avait un mouchard de Batista aux environs, pensai-je, c'était lui.
"Oh, fis-je d'un air vague, j'ai envie de voir la ville, les endroits intéressants" - et nous voilà partis, descendant jusqu'au port, remontant jusqu'au monument aux fusiliers marins tués pendant la guerre hispano-américaine, à l'hôtel de ville... je me voyais déjà reconduit à l'hôtel, à moins de trouver un prétexte.
"N'avez-vous pas une vieille église, San Francisco ?" Si cette église existait, elle se trouverait sûrement dans la rue qui portait le même nom.
Je ne m'étais pas trompé : l'église existait, et elle était située dans la rue en question. Je dis à mon guide que je me débrouillerais pour regagner l'hôtel par mes propres moyens - je désirais prier. Ma déambulation dans le cloître ne tarda pas à être interrompue par un prêtre, hostile et soupçonneux : je ne pouvais guère lui expliquer que je voulais simplement m'abriter le temps que mon taxi et mon guide noir lèvent le camp.
Une fois ce problème réglé commença la longue remontée de la calle San-Francisco sous le soleil accablant de midi. La rue était aussi longue qu'Oxford Street, et le numéro que je cherchais se trouvait à l'autre bout. Je n'étais qu'à mi-parcours quand une voiture vint s'arrêter à ma hauteur. M. X... et le correspondant de Time.
"Nous vous avons cherché partout", fit M. X... d'un ton plein de reproche.
J'essayai de m'inventer une histoire qui expliquerait ma présence, sous un soleil de plomb, dans cette rue interminable.
"Tout va bien, poursuivit M. X..., tout est parfaitement en règle. J'ai découvert que mon réseau vous avait contacté." Je pus ainsi achever le trajet confortablement installé dans leur voiture.
DANS la maison, qui appartenait à une riche famille bourgeoise de Santiago, se trouvaient la fille de La Havane, sa mère, un prêtre et un jeune homme occupé à se faire teindre les cheveux par un coiffeur. Ce jeune homme, un avocat du nom d'Armando Hart, devait devenir par la suite ministre de l'éducation sous la présidence de Castro, puis deuxième secrétaire du Parti communiste cubain. Quelques jours auparavant, il s'était évadé du palais de justice de La Havane où il venait d'être amené sous escorte militaire afin d'être jugé. Il y avait une longue file d'accusés - avec un soldat à chaque bout. Hart connaissait l'endroit exact, à côté des toilettes, où le couloir tournait et où il échapperait, l'espace d'un instant, à la vue de la sentinelle de tête comme celle de la sentinelle de queue. Il se glissa à l'intérieur des toilettes et s'esquiva par une fenêtre ; ses amis l'attendaient dehors, dans la rue. Son absence ne fut pas remarquée jusqu'à l'appel de son nom devant le tribunal.
Sa femme, aujourd'hui connue de toute l'Amérique latine sous le nom de Haidée Santamaria, se trouvait avec lui : une femme jeune et à la mine égarée qui donnait l'impression, à cette époque-là, d'avoir été précipitée dans le fanatisme par la brutalité d'événements qui échappaient à son contrôle. Avant d'épouser Hart, elle avait été fiancée avec un autre jeune partisan de Fidel, à Santiago en 1953. On amena la jeune femme à la prison pour lui montrer le cadavre de son fiancé, châtré et les yeux crevés.
LE lendemain de mon arrivée, trois sœurs âgées de huit à dix ans furent enlevées de leur maison au milieu de la nuit par des soldats. Leur père avait fui Santiago pour rejoindre Castro dans le maquis, et les fillettes, vêtues de leurs chemises de nuit, furent emmenées comme otages dans une caserne.
Le lendemain matin, j'assistai à la révolte des enfants. La nouvelle de l'arrestation des fillettes s'était répandue dans les écoles. Les élèves des écoles secondaires prirent d'eux-mêmes l'initiative de quitter leurs établissements et de se répandre dans les rues. Les parents vinrent retirer leurs enfants des maternelles. Les rues étaient pleines. Les commerçants, craignant le pire, baissèrent leurs rideaux. L'armée céda et libéra les trois fillettes. Ils ne pouvaient braquer les lances d'arrosage sur les enfants comme ils l'avaient fait pour leurs mères, ou les pendre aux réverbères comme ils l'auraient fait pour leurs pères. La chose étrange à mes yeux est qu'aucun reportage sur la révolte des enfants ne fut publié dans Time dont le correspondant se trouvait pourtant sur place avec moi. Peut-être Henry Luce n'avait-il pas encore choisi entre Castro et Batista.
Graham Greene


