Leonardo Padura : « J’aurai toujours besoin de Cuba pour vivre et écrire »
Le nouvel ouvrage de Leonardo Padura est une tornade littéraire, un roman qui vous emporte dans le tourbillon de la vie à la suite d’itinéraires entremêlés d’une bande d’amis qui, depuis La Havane, racontent les turbulences du monde.
Entretien.
Publié le 16 septembre par le quotidien L’Humanité.
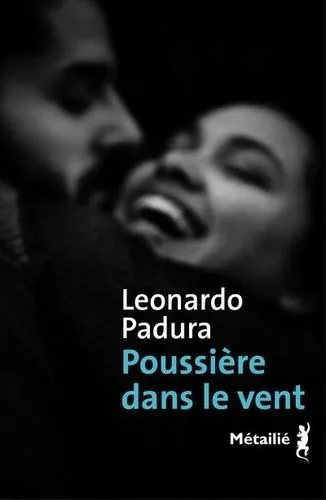
Lorsqu’on referme le livre, on est groggy. Seraient-ce les effluves d’un vieux rhum cubain qui s’échappent des pages ? Pas envie de lâcher cette bande d’amis dont les vies, tumultueuses, bousculées, déchirées, nous sont si proches. Enfants de la révolution cubaine, ils vont traverser le pire et le meilleur, la vie et la mort, l’exil et les retrouvailles. L’écriture de Padura procède par strates, déployant de manière hypnotique et anachronique un récit qui vous tient en haleine, jusqu’au bout, jusqu’à ce fichu point final qui vous oblige à vous séparer de Clara et des autres. À travers la destinée d’une bande d’amis nés à l’aune de la révolution cubaine, Leonardo Padura écrit un roman puzzle, un roman voluptueux, sensuel, aussi vertigineux que terrible tant les interrogations qu’il soulève sont aussi un peu les nôtres. S’il y a du désenchantement, il n’y a ni renoncement ni amertume.
L’amitié semble le socle de votre roman…

Leonardo Padura Sans aucun doute. On qualifie souvent ce roman de roman de la diaspora en oubliant le thème fondamental, l’amitié. Avec ses deux facettes : la fidélité et la trahison. Je parle d’une génération qui a connu la frustration, le désenchantement, la dispersion, mais qui jamais n’a perdu le lien avec le pays natal.
Il y a Cuba, caracol (« escargot »), Clan, casa (« maison ») et Clara…
Leonardo Padura Un roman dopé à la vitamine C ! Cuba, c’est le lieu originel, là où les relations personnelles, amoureuses, amicales, culturelles se nouent de manière indélébile. Et ce lieu peut être une consolation ou une malédiction parce qu’il te poursuit toute ta vie. Le Clan, c’est ce groupe d’amis qui se rencontrent dans des temps de croissance et d’espoir. Tous portent de grands rêves de futur. Tous vont souffrir devant le destin frustré de leur génération. La maison (la casa), c’est un morceau de Cuba que nous conservons où que nous soyons. Le caracol (l’escargot), parce que nous cherchons tous un refuge quelque part. Enfin Clara, au-delà de sa maison-escargot, est le cœur, le champ magnétique qui attire et maintiendra uni tout le Clan, malgré sa dispersion.
Vous racontez non pas l’exil mais des exils dont les motivations diffèrent selon les époques. Même si l’exil, quelles que soient ses raisons, est toujours une déchirure…
Leonardo Padura C’est le drame permanent de Cuba. Depuis que nous sommes cubains, depuis la fin du XIXe siècle, l’histoire de Cuba est faite d’exils. Le poète José Maria de Heredia fut le premier exilé. L’exil nous poursuit, nous rattrape tous. Moi-même je n’y échappe pas, une grande partie de ma famille est exilée. Depuis la révolution, on a connu des exils politiques et économiques. Ces derniers temps, l’exil est motivé pour des raisons aussi bien politiques qu’économiques, familiales ou le besoin de changer d’horizon. Désormais, les Cubains exilés peuvent retourner au pays et l’exil n’est plus ce drame que beaucoup ont connu.
Au fil des pages, vos personnages acquièrent l’étoffe des héros. Des héros du quotidien. Ce qu’ils vivent lors de la « période spéciale », durant les années 1990, est terrible…
Leonardo Padura Avoir survécu dans ces années-là à Cuba, ballottés entre pénurie alimentaire et désenchantement, fut un acte héroïque que tous les Cubains n’ont pu affronter. Certains de mes amis sont devenus alcooliques. D’autres sont partis. Si héros il y a, il faut parler d’héroïnes, des femmes cubaines. Ce sont elles qui ont accompli des miracles, ont multiplié les pains et les poissons sans avoir un seul morceau de pain ou de poisson. La maison de Clara est Cuba. Son jardin à l’anglaise s’est métamorphosé en un potager, avec quelques clapiers et un poulailler. Clara était ingénieure et elle est devenue paysanne.
Votre description de cette décennie, de cette période spéciale, est vertigineuse…
Leonardo Padura Personne ne peut imaginer ce que nous avons vécu. Il manquait de tout, de tout. Chacun a inventé des stratégies de survie. Au début des années 1990, j’écrivais un peu pour la Gazeta de Cuba. Trois fois par semaine, je parcourais quinze kilomètres pour me rendre au travail. Quinze kilomètres sur un vélo chinois, une torture ! Mais je n’avais pas le choix. Nous n’avions rien mais, paradoxalement, et même heureusement, j’ai eu du temps, du temps pour écrire. Dès lors, j’ai écrit comme un fou pour ne pas devenir fou. Entre 1990 et 1995, j’ai écrit trois romans, un livre sur Alejo Carpentier, des nouvelles, des reportages, des scénarios de film. En 1995, j’ai reçu le prix du café Gijon pour mon roman Électre à La Havane. Et ma vie a changé du tout au tout. Malgré ce prix, cette reconnaissance à l’international et dans mon propre pays, je n’ai jamais éprouvé le désir de quitter Cuba.
Pourquoi ?
Leonardo Padura J’ai toujours rêvé, comme tout un chacun quand il découvre un pays, une ville, de m’installer à Florence ou à Sitges car j’ai eu la possibilité de découvrir ces endroits merveilleux. Lorsque, en 1992, je peux aller aux États-Unis, tout le monde est persuadé que je ne reviendrai pas. Mais je suis revenu. Et je reviendrai toujours. J’ai compris que j’aurais toujours besoin de Cuba pour vivre et écrire.
Quid de la censure à Cuba ?
Leonardo Padura Mes livres sont publiés, y compris l’Homme qui aimait les chiens (sur l’assassinat de Trotski – NDLR). L’an dernier, j’ai eu la plus haute distinction littéraire cubaine. Mais, curieusement, on m’invite peu à la télévision ou à la radio pour parler de mes livres. Il n’existe pas un bureau de la censure à Cuba mais quelques fonctionnaires zélés qui ont généré une stratégie d’autocensure. Dans mes livres, j’écris tout ce que je dois écrire. Ce ne sont pas des documents directement politiques mais ils contiennent une grille de lecture politique possible.
Vos personnages lisent toute la littérature universelle, y compris Orwell et Kundera, des auteurs alors « interdits »…
Leonardo Padura Durant des années, nous avons pu lire toute la littérature universelle. Le Quichotte est édité à un million d’exemplaires. Le Chien jaune, de Simenon, a été édité en 1971 et vendu à 50 000 exemplaires alors que personne n’avait entendu parler de lui. Pourtant, certains auteurs n’étaient pas publiés : Cabrera Infante, Orwell, Kundera, Boulgakov… mais tous ceux qui le souhaitaient parvenaient à se procurer leurs livres. La découverte de Cabrera Infante fut pour moi un choc. J’ai trouvé dans ses livres une écriture qui allait être ma langue… Je ne peux même plus vous dire comment nous dénichions ces livres, mais on les dénichait !
Parlons de la construction du roman, de sa structure, par strates, sans chronologie apparente…
Leonardo Padura C’est un roman qui s’est construit lui-même. Je n’avais pas une idée de sa structure, je savais ce qui allait advenir dans les premier et deuxième chapitres, point. Je les ai écrits et j’ai alors basculé dans la jungle obscure. J’ai écrit le troisième et j’ai rebasculé dans la jungle obscure. Au fur et à mesure, je voyais défiler le texte en construction et je faisais des allers-retours incessants à la recherche du mot juste, de la cohérence. Un travail intense qui a duré deux années. Je travaillais six heures par jour, j’éprouvais le besoin de tenir tous les fils pour solidifier la structure romanesque. On peut comparer ce roman à un kaléidoscope où les choses, les couleurs se voient différemment jusqu’à ce qu’elles finissent par s’assembler.
Contrairement à vos autres romans, La Havane est absente, fantomatique. On ne quitte pas la maison de Clara. En revanche, la géographie du livre nous emporte à Miami, Madrid, New York, Buenos Aires…
Leonardo Padura Je suis mes personnages à la trace. Pour Mario Conde (détective, personnage récurrent de nombre d’ouvrages de l’auteur – NDLR), son havanité était primordiale. Avec lui, on pouvait dessiner une cartographie de La Havane. Ici, mes personnages vont ailleurs et cela me permet d’écrire dans un autre espace, une autre temporalité. C’est peut-être un geste de rébellion contre l’insularité qui vous colle à la peau quand on est cubain… À Miami, les Cubains ont construit en territoire étranger une forteresse culturelle 200 % cubaine que tu éprouves juste en regardant les gens marcher, avec cette nonchalance propre aux Cubains. Madrid, c’est la référence pour toute la communauté culturelle hispanique, la ville qui a permis la plus grande intégration cubaine. Les enfants de Cubains nés en Espagne sont désormais plus espagnols que cubains. C’est la tragédie du siècle : tes enfants sont désormais du lieu où ils naissent…
Parlons de la révolution cubaine, celle qui a accompagné la jeunesse de vos personnages et vous-même. Où en est-elle aujourd’hui ?
Leonardo Padura La révolution cubaine a été un processus social et culturel qui, indiscutablement, a changé la structure politique et sociale du pays. Comme toute révolution, elle a eu ses avantages et ses inconvénients. Mais c’est une révolution dont la première grande mesure culturelle a été d’alphabétiser le pays, de démocratiser l’accès à la santé, à l’éducation. Une révolution qui a vu le jour dans un monde partagé en deux blocs et qui n’a eu d’autre choix que de se ranger du côté soviétique. Et là, les choses se sont compliquées. Notre économie dépendant de l’Union soviétique, le jour où l’URSS a disparu, tout s’est effondré et nous avons basculé dans cette période « spéciale ». Nous avons pris conscience de la réalité du « réalisme socialiste ». Le désenchantement vient de là. Cette révolution a atteint aujourd’hui son point critique. Ou elle est capable de se régénérer, de s’autorévolutionner, ou elle disparaît. Le temps est venu d’avoir l’intelligence de prendre des décisions, d’imaginer une projection raisonnable et de raisonner pour révolutionner non seulement l’économie mais aussi la politique et la société cubaines. Il s’agit d’imaginer une révolution qui tienne compte des aspirations des nouvelles générations tout en préservant ce qui a été le plus bénéfique pour le peuple cubain. Le 11 juillet 2021, le peuple est descendu dans les rues de La Havane pour les mêmes raisons que le peuple français est descendu dans les rues de Paris en 1789 : pour le pain et la liberté. Quand le peuple réclame la liberté, cela signifie que nous sommes entrés dans un moment politique et social critique.
Le titre du livre est tiré d’une chanson du groupe Kansas dans les années 1970, Dust in the Wind, « poussière dans le vent ». Cette chanson a bercé votre génération. Comment était-ce possible ?
Leonardo Padura Ma génération a grandi en écoutant la musique pop et rock anglo-saxonne. Nous l’écoutions semi-clandestinement grâce à nos radios soviétiques qui nous permettaient de capter les ondes états-uniennes. Cette chanson est liée à notre éducation sentimentale. On écoutait les Beatles et Kansas. Le groupe m’a généreusement cédé les droits pour mon titre. Et cette chanson colle parfaitement à mes personnages et leur a permis d’aller de l’avant.


