Que cachaient les néons de la Cuba des années 50 ?
Chaque fois que les médias au service du gouvernement des États-Unis, la presse corporative ou le réseau de sites web contre-révolutionnaires font référence à la Cuba d’avant 1959, ils la dépeignent comme la toile d’un pays qui n’a jamais existé.
Ils le font comme s’il s’agissait d’une photo de magazine, d’un spot publicitaire, et comme ce qu’ils nous vendent obéit à la tentative d’un retour désespéré à cet « âge d’or », il faudrait, selon eux, tout ramener en arrière, repartir de zéro, balayer un par un les pas franchis par la Révolution pour la dignité du peuple, jusqu’à ramener nos campagnes et nos villes au point exact de la réalité sociale surmontée par la victoire de l’armée rebelle en 1959. }

Le dénuement et la pauvreté de la majorité de la paysannerie cubaine figuraient parmi les problèmes chroniques auxquels la Révolution s’est trouvée confrontée et qu’elle a dû transformer. Photo : Alberto
Korda
Que se cachait-il derrière les néons de la Cuba des années 50 ? Derrière le décor commercial coulait le sang des crimes de la dictature de Batista, des institutions qui allaient servir de modèle à la répression en Amérique latine, comme le Bureau de répression des activités communistes (brac), le Service de renseignement militaire (sim), le Service de renseignement naval (sin), la Police maritime, le Bureau d’investigation et la Police nationale, véritables académies de la torture et de la mort.
La Havane était un paradis, soit, mais pour les mafias du jeu, de l’alcool, de la drogue et de la prostitution, un royaume d’impunité qui s’est développé comme une « ville du péché », parallèlement à Las Vegas, mais avec de grands avantages sur la perle du Nevada.
Ce qui se passait à La Havane restait à La Havane. Il n’y avait pas un seul endroit fréquenté sans point de vente de drogue, sans table de jeu, sans vendeur de billets de loterie. Alcool à flots et prostituées à gogo...
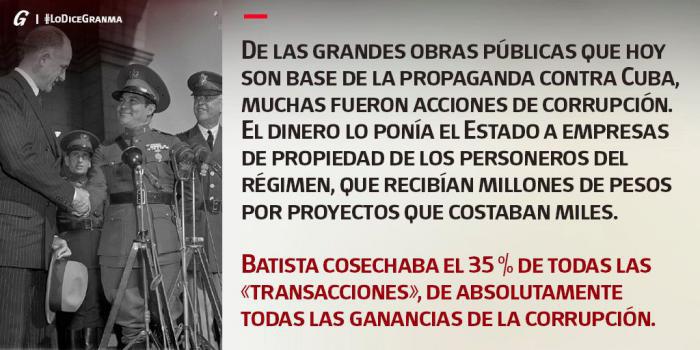
L’argent du pays fut utilisé pour construire des hôtels et des casinos éblouissants dont les bénéfices étaient transférés quotidiennement vers les États-Unis. C’était un « business » très lucratif grâce à Batista, l’homme fort pour qui tout était bon pour plumer le peuple, pour s’enrichir à ses dépens en se livrant à des affaires sales qui n’étaient d’aucune utilité pour le pays.
Parmi les grands travaux publics qui sont aujourd’hui à la base de la propagande contre Cuba, comme un symbole de la réussite de cette république bourgeoise, beaucoup furent le fruit d’actes de corruption. L’argent fut versé par l’État à des entreprises appartenant à des membres de la clique du régime, qui reçurent des millions de pesos pour des projets qui en coûtaient des milliers.
Batista empochait 35% de toutes les « transactions », d’absolument tous les bénéfices tirés de la corruption.
LA PETITE TASSE EN OR
Dans cette Cuba « merveilleuse » Cuba, des milliers de personnes occupaient des postes dans les ministères et étaient payées sans travailler ; des services publics gratuits et des sinécures étaient accordés à titre de faveurs politiques…
Alors que la capitale regorgeait de casinos et d’hôtels de rêve, cathédrales de la tromperie et de la tricherie, l’autre face de la ville offrait le visage douloureux de l’extrême pauvreté.
Des centaines de bidonvilles poussaient comme des champignons. Las Yaguas, la Cueva del Humo et tant d’autres îlots de misère grandirent à l’ombre des nouvelles constructions somptueuses.
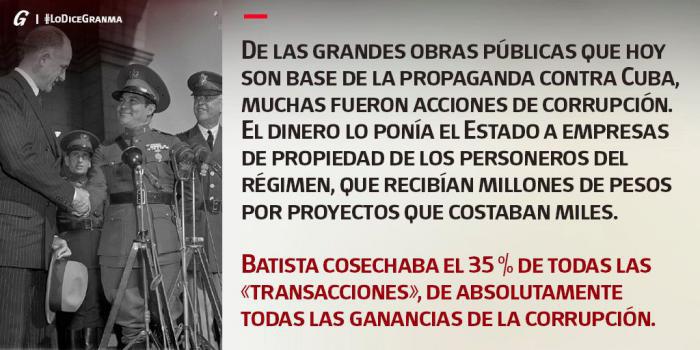
Dans le quartier de Las Yaguas, comme on peut le constater dans le magazine Bohemia, des milliers de familles vivaient dans des conditions infrahumaines, dans des habitations faites de feuilles de palmier utilisées par l’industrie pour emballer les feuilles de tabac, devenues déchets avant d’être recyclées en murs et en toits.
Des jeunes filles paysannes, amenées sous de faux prétextes dans la capitale, étaient exploitées dans la fameuse ceinture de prostitution qui desservait hôtels, casinos et cabarets.
L’Île paradisiaque appartenait à Meyer Lansky, Santo Trafficante, Amleto Battisti Lora, Joe Stassi, Amadeo Barletta et Fulgencio Batista ; cinq capos, un président, une seule mafia...
Depuis les années 30, le Sicilien Santo Trafficante, chef en second de ce qui fut connu comme « l’Empire de la Havane », la face visible des affaires de la mafia nord-américaine à Cuba, qui avait son quartier général au cabaret Sans Souci, était chargé de faire venir la cocaïne de Medellin, en Colombie, et l’héroïne de Marseille.
Pour mener à bien ces opérations, ils fondèrent à Cuba des compagnies aériennes qui opéraient dans des aéroports militaires, avec des équipements et des techniciens de l’armée de l’air cubaine, protégés par les militaires et la police nationale. La Havane était également le centre de blanchiment d’argent le plus important des Amériques.
UN PAYS « DÉVELOPPÉ »

Concernant cette Cuba que la contre-révolution se targue aujourd’hui de présenter comme « un pays développé », le recensement de 1953 est sans appel : 68,5% des paysans vivaient dans des « bohios » (cabanes) misérables avec des toits de feuilles de palmier et des sols en terre battue, 85% des familles n’avaient pas l’eau courante et 54% ne disposaient pas d’installations sanitaires.
Seulement 11 % des familles consommaient du lait, 4 % de la viande et 2 % des œufs, 44 % ne savaient ni lire ni écrire et, selon le Conseil économique national, 738 000 personnes étaient au chômage en 1958, sur une population d’un peu plus de 6 millions d’habitants.
Près de 3 millions de Cubains n’avaient pas l’électricité, l’infrastructure ne couvrant que 56 % du pays.
Au triomphe de la Révolution, on dénombrait 600 000 enfants privés d’écoles et 10 000 enseignants sans emploi. Un million et demi d’habitants âgés de plus de six ans non scolarisés, à peine 17 % des jeunes âgés de 15 à 19 ans avaient reçu un enseignement quelconque et la population âgée de plus de 15 ans affichait un niveau d’éducation moyen inférieur à la troisième année.
Dans les villes, une personne sur cinq ne savait ni lire ni écrire ; dans les campagnes, un paysan sur deux était analphabète, et les rares écoles qui existaient étaient abandonnées.
Seuls 20 % des terres arables étaient exploitées, tandis que 60 % des denrées alimentaires étaient importées des États-Unis. Plus de la moitié des meilleures terres du pays étaient entre des mains étrangères, et les propriétés de la United Fruit Company et de la West Indian reliaient la côte nord à la côte sud de l’ancienne province d’Oriente.
LE LOGEMENT MONTRÉ COMME UN EXEMPLE POUR L’AMERIQUE LATINE
Selon des données d’Inter Press Service (ips), à la prise du pouvoir par la Révolution, « le parc immobilier était gravement détérioré, en raison de l’énorme déficit de logements, des différences notables entre les campagnes et les villes, de la variabilité des matériaux utilisés et de l’existence de ceintures de pauvreté dans les principales villes, notamment à La Havane ». Une étude de 1953, coordonnée par le Bureau du recensement des États-Unis, a conclu que seulement 13 % des maisons pouvaient être évaluées comme bonnes.
Dans la capitale proprement dite, on trouvait d’une part un littoral opulent avec des lotissements bourgeois exclusifs, des immeubles d’habitation luxueux et des résidences somptueuses, et d’autre part d’immenses zones de bidonvilles.

Dans les conditions de sous-développement économique que connaissait Cuba, les ressources en eau étaient gérées de manière précaire. Sur les 300 localités de plus d’un millier d’habitants, seules 114 disposaient d’une alimentation en eau par réseau et 12 d’un système d’égouts.
Au début de l’année 1959, on comptait 16 installations de chloration en service, et sur quatre stations d’épuration à Camagüey, Santa Clara, Palma Soriano et Cienfuegos, deux présentaient des problèmes dus au manque de produits chimiques et une ne fonctionnait plus depuis trois ans.
Le système d’évacuation des eaux usées de La Havane avait presque 50 ans et était insuffisant.
La seule station d’épuration, située à Santa Clara, avait été désaffectée, et les stations d’épuration de Holguin, Guantanamo et Pinar del Rio étaient en construction depuis plusieurs années.
Il n’y avait que 13 petits barrages dans le pays, répartis à Camagüey, Las Villas, Holguin et Santiago de Cuba.
Bien entendu, un tel inventaire d’arguments ne saurait convenir aux « restaurateurs de liberté », à ceux qui rêvent d’un retour aux années 50, et les « experts » comme les naïfs qui « avalent » la supercherie ne diront surtout pas que la cause de tout cela était la condition de néo-colonie yankee, des maux qui avaient plongé le pays dans une situation de chaos, avec les niveaux les plus indignes de sous-développement, de dépendance et à la merci d’une camarilla de militaires assassins, de fonctionnaires vénaux et de mafieux.
Ils ne diront pas non plus que c’est la misérable réalité vécue par la Cuba profonde qui donna une chaleur populaire à l’insurrection, à la guérilla qui secoua les montagnes, précipitant le pays dans une Révolution radicale ; cette même Révolution qui aujourd’hui, invaincue, héroïque, en résistance permanente, aspire à la prospérité, une prospérité entravée par un blocus imposé par ceux qui la convoitent et l’invoquent, nostalgiques des années 50 avides de mettre en vente le pays au prix de sa dignité en forçant un retour à un passé à jamais révolu.


